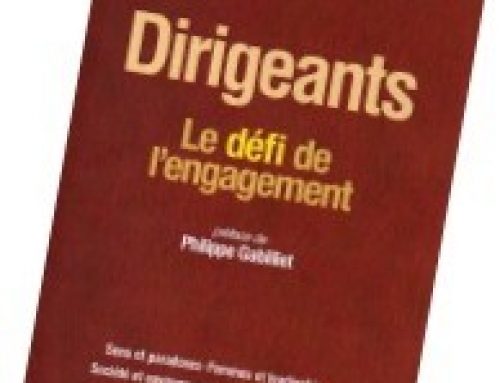Dans un contexte économique de moins en moins prévisible, un environnement plus complexe et systémique, l’entreprise collaborative, souvent synonyme d’entreprise libérée, est présentée comme le moyen de répondre à des impératifs d’agilité, à un besoin de se réinventer, de susciter plus d’innovation, de capter des signaux faibles en interne et en externe, ainsi qu’à un besoin de fidéliser ses collaborateurs, et de mettre en valeur toutes leurs potentialités.
Plusieurs questions se posent d’emblée : le développement d’une économie collaborative, soit l’intégration de l’impact social des entreprises au cœur de leur activité économique, entraine-t-il nécessairement une redéfinition de leur mode de management ? Si cette implication se vérifiait, pourquoi l’entreprise collaborative serait-elle forcément une entreprise libérée – qui s’affranchit d’un management hiérarchisé ? L’entreprise libérée n’est-elle pas un mythe ? Est-elle une solution réservée aux entreprises de la « nouvelle » économie, donc l’organisation se construit ex nihilo, sans référent préalable, ou peut-elle aussi être le fruit d’une transformation lourde concernant de grandes entreprises hyper-processées et aux traditions fortement ancrées ? Concrètement, qu’est-ce que cela change pour les salariés et les clients ? En quoi les métiers et modèles de gouvernance sont-ils touchés ? Finalement, quelles évolutions cela implique pour le manager et le leader ?
Si ces problématiques sont relativement nouvelles, elles ont déjà été théorisées, et pour les désigner l’on regroupe généralement les modes d’organisation collaboratifs sous le terme d’ « holacratie », issu des mots grecs « holos » qui renvoie à une entité à la fois tout et partie d’un tout, et « cratos » signifiant pouvoir. L’holacratie impose, propose le partage du pouvoir et des influences à l’intérieur de l’entreprise, de sorte que les interdépendances entre individus et groupes de toutes échelles se renforcent. Les créations d’entreprises de cette forme se multiplient, parmi les plus emblématiques, l’on peut citer l’équipementier automobile basé dans la baie de somme FAVI (qui a publié L’entreprise qui croit que l’homme est bon) ; Invov-on, groupe familial développeur de services innovants dont quatre valeurs centrales orientent les activités (la performance par le bonheur, l’amour du client, des équipes respectueuses et responsables, l’ouverture d’esprit et l’esprit d’ouverture) ; le groupe Poult, biscuitier qui a notamment vu disparaître plusieurs lignes hiérarchiques, se redéfinir les grilles de salaire, etc. De moins en moins marginales, ces initiatives ont potentiellement des conséquences qui dépassent largement les frontières de l’entreprise, en ce sens que transformer l’organisation des entreprises c’est surtout transformer les hommes qui y travaillent.

Cartographie du live tweet (Interconnexion entre les différentes personnes ayant participé aux tweetos)
Mehdi Berrada
Poult n’était a priori pas le candidat idéal pour engager une transformation vers un mode d’organisation collaboratif. D’abord en raison de sa taille (180 millions d’euros de chiffre d’affaire, 800 collaborateurs), mais également pour la présence d’un actionnariat financier, le secteur (grande distribution), et la faible valeur ajoutée de l’activité de biscuitier. Il est ainsi un exemple parmi d’autres qu’aucun présupposé ne doit venir enrayer des velléités de transformation : nombre de dirigeants qui ont évalué la possibilité d’un basculement aux modes collaboratifs ont finalement, par réflexe défensif, estimé que la taille, le secteur d’activité ou autres contraintes quelconques de leur entreprise interdisait toute évolution de ce genre. Toute entreprise a ses droits d’entrée dans le cercle encore assez privé des adeptes du management collaboratif. Reste encore à se demander pourquoi vouloir en faire partie.
En ce qui concerne Poult, identifier les vraies raisons de la transformation engagée il y a neuf ans implique d’éviter le biais de la post-rationalisation. Si elles sont sans doute plus difficiles à appréhender aujourd’hui, l’on peut affirmer qu’elles correspondent à la nécessité de voir l’entreprise se renouveler pour mieux répondre aux défis d’un monde changeant. Ces changements déclencheurs de la transformation revêtent au moins cinq aspects, que sont (1) l’accélération même du changement, donc l’impossibilité des prévisions, (2) l’accélération de la transmission de l’information qui rend l’avantage compétitif plus éphémère, (3) l’accessibilité grandissante des savoir-faire, à tel point que « la compétence devient une commodité », (4) le développement de nouveaux procédés de collaboration, notamment informels, comme Wikipédia, (5) la fragmentation de la demande.
Plus généralement, un constat simple et apparemment irréfutable peut faire envisager aux dirigeants la pertinence d’un changement : les modèles d’organisations auxquels se conforment la grande majorité des entreprises ont été créés au début du XXème siècle pour répondre à des besoins qui aujourd’hui ont disparu. D’abord, la rigidité des organisations convenait bien à l’élaboration de produits standards pour équiper les classes moyennes, dont les désirs de consommation n’ont aujourd’hui plus rien à voir. Ensuite, un mode de management hiérarchisé était convenable quand grand nombre des salariés n’avaient pas reçu de formation, étaient moins éduqués, puisqu’issus des zones rurales et en donc en reconversion. En outre les cycles économiques étaient beaucoup plus longs et n’exigeaient pas autant de flexibilité qu’aujourd’hui de la part des organisations, qui doivent être toujours plus agiles et innovantes.
Un autre élément doit être pris en compte par les dirigeants. L’on réserve aujourd’hui l’exercice de l’intelligence dans l’entreprise à une équipe très restreinte, or tout porte à croire qu’une mutualisation des intelligences est plus productive. Même une personne extrêmement intelligente ne l’est pas plus que dix personnes dont les intelligences sont correctement mises en commun. Si l’on admet – et cela semble difficilement réfutable – que l’essence de l’entreprise est d’être une mise en commun des compétences dans le but d’une réussite collective, alors mettre fin au monopole de l’exercice de l’intelligence dans l’entreprise doit être envisagé en tant qu’alternative. Les divergences d’intérêt n’ont rien à faire en son sein, ce pourquoi il faut chercher à s’en libérer. L’on peut sans doute penser comme cela le rapport entre entreprise collaborative et entreprise libérée questionné en introduction : l’entreprise collaborative, c’est l’entreprise libérée des divergences d’intérêts qui nuisent à la collaboration, laquelle est en fait l’essence même de l’entreprise. L’entreprise collaborative n’est donc pas une utopie mais la réalisation, la concrétisation même de l’entreprise telle qu’elle est censée exister. Elle présente en plus de cela une dimension pragmatique en ce sens qu’elle permet de mieux faire face à un environnement qui change, voire de ne plus y faire face, puisque d’une certaine manière elle s’y inscrit, réconciliant toutes les parties prenantes avec la réussite.

Une fois identifiées les raisons du changement, se pose la question des moyens d’y parvenir. Comment changer ? C’est là toute l’ambiguïté et la difficulté de cette transformation, qui ne peut s’appuyer sur aucun procédé, aucune méthode, aucun manuel de management. Elle nécessite une part d’irrationnel, du moins de « non-rationnel », c’est-à-dire d’intuitif, immensurable. Si le pas est dur à franchir, c’est sans doute qu’il s’agit moins de modifier l’édifice que de le rebâtir, et ce dès la première pierre. L’entreprise collaborative a opéré un changement de postulat fondamental : dorénavant, l’on suppose que les hommes sont honnêtes, exigeants, travailleurs. Ce qui semble être une lapalissade n’a en fait aucune traduction dans la réalité de la plupart des entreprises, encore organisées de manière centralisée, ayant recours à un contrôle parfois infantilisant de leurs collaborateurs pour étouffer leurs tendances viles à la tromperie, la suffisance, la paresse. Elles oublient là que l’homme a la caractéristique -fâcheuse ou heureuse donc- de se conformer à l’image que les autres ont de lui. Poult a fait le pari d’inverser la charge de la preuve, ce qui n’est pas sans conséquence sur la mission du dirigeant. Dès lors que l’on adopte cette vision optimiste de l’homme, le dirigeant devient responsable de créer les conditions d’expression de toutes les potentialités, et ne peut plus tenir un discours accusant les employés des pires défauts. A l’image du jardinier, son rôle n’est pas de passer son temps à mesurer la taille des fleurs mais de s’assurer qu’il y a un terreau favorable à l’émergence d’un beau jardin, et à défaut de s’employer à le créer.
Concrètement, une transformation de ce genre est un travail de longue haleine. Chez Poult, il a d’abord fallu la concentrer sur un unique site de production, servant donc de laboratoire à l’expérience. 400 personnes ont préalablement été réunies sur une journée, avec pour objectif de commencer à imaginer une nouvelle organisation du site en tentant de répondre à ces problématiques (1) comment permettre aux équipes d’être plus autonomes ? (2) le niveau hiérarchique actuel est-il adéquat ? Par groupes de 20 personnes représentant la diversité du site, ils se sont engagés dans une réflexion prolongée, pour finalement exprimer le souhait d’une hiérarchie à trois niveaux (contre six au moment de l’expérience) avec une organisation en réseau d’équipes autonomes. L’expérience s’est très vite avérée concluante, notamment d’un point de vue humain : « ça vous donne foi en l’humanité » nous dit Mehdi Berrada. La généralisation à l’ensemble du groupe ne s’est donc pas fait attendre, et pour en décider les modalités des réunions mensuelles des collaborateurs ont été nécessaires sur une durée de deux ans. Il ajoute que « ces réunions ont débouché sur un large consensus sur la sortie de l’organisation fonctionnelle, qui de toute évidence nuisait à la collaboration, mais qui surtout ne permettait pas aux collaborateurs d’avoir une vision totalisante de leur mission, aveuglement destructeur de sens. » Travailler sur un projet depuis sa conception jusqu’à sa réalisation était, de l’aveu de tous, une perspective grisante et, comme nous l’avons mentionné, porteuse de sens. S’est donc mise en place une « organisation en équipe autonomes de familles de produits », qui se présente comme suit : 12 équipes autonomes sont en charge d’autant de grands segments de produits avec chacun leur technologie propre, et appuyées par des fonctions support en charge du maintien d’une stratégie à moyen-terme. Au lieu d’une pyramide, l’organisation prend plutôt la forme d’une multitude de cercles concentriques qui correspondent aux 12 segments, avec au centre les équipes de production (en charge des lignes de production) puis autour les équipes marketing, R&D, maintenance, etc. La dimension fonctionnelle est donc de toute évidence fortement diluée. Il n’y a plus de comité de direction, ni de directions de fonctions, hormis le directeur financier dont la présence est rendue indispensable par celle des investisseurs. De nombreuses personnes qui en théorie avaient à y perdre à titre individuel dans ce nouveau mode d’organisation se sont finalement vues satisfaites des changements effectués ; surtout, de nombreuses autres se sont révélées. Néanmoins, Poult n’a pu faire en sorte d’éluder totalement les décisions centralisées, et il a fallu créer des centres de décision : (1) la division « projet d’entreprise » dont la mission est de s’assurer que le projet d’entreprise continue d’avancer, d’identifier ce qui fonctionne moins bien et d’annoncer les prochaines transformations à mener. Il est composé de personnes très diverses qui se sont portées volontaires. (2) Une équipe CAPEX : beaucoup d’investissements sont faits chaque année et les équipes autonomes ne peuvent pas investir sans prendre en compte ce que font les autres. L’équipe CAPEX est ainsi en charge de la fluidité et de la transparence de l’information relative aux investissements, ainsi que de la prise de certaines décisions relatives aux investissements. Ses membres sont cooptés par chaque famille de produit. Les décisions y sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée en cas de désaccord au 1er tour. Pour décider des modalités de fonctionnement de cette équipe, une journée a également été organisée, au cours de laquelle tous ceux qui le souhaitaient se sont rassemblés, sur la seule base du volontariat. L’équipe (qui est renouvelée d’un tiers tous les ans) se réunit régulièrement. Sa position centrale vis-à-vis de la collectivité (et non plus frontale comme c’est peut-être le cas pour une équipe de direction), le fait qu’elle en soit partie intégrante, sont à l’origine d’une conscience exacerbée de ses responsabilités vis-à-vis des autres collaborateurs, qu’elle s’efforce donc d’informer au mieux des décisions prises à travers la rédaction de comptes rendus accompagnant chaque réunion.
La transparence et la mise à disposition des informations à tous au sein du groupe, sont une étape essentielle de la transformation, et permettent d’en finir avec l’infantilisation des employés. Ceux-ci doivent être en mesure de comprendre la nature et la finalité de chaque décision : l’arbitraire n’a pas sa place dans l’entreprise collaborative, notamment parce qu’il participe du maintien des luttes d’égos et des conflits d’intérêts personnels. L’on peut illustrer cela d’un exemple : lorsque deux enfants se disputent, chacun voulant regarder un DVD différent, poursuivant ainsi son intérêt égoïste, deux possibilités semblent envisageables pour les parents. La première est de choisir arbitrairement le DVD qui sera visionné par les enfants. Si cela aura le mérite de mettre provisoirement fin au conflit, cela générera frustration, incompréhension et maintien de l’opposition des intérêts personnels. La seconde est d’accorder aux enfants 5 minutes de réflexion à la suite desquelles, si aucune décision commune n’a été trouvée, personne ne regardera de DVD. Cette seconde approche, plus responsabilisante, incite notamment à la prise en compte de l’altérité. C’est son extension à toute l’entreprise qui permet aujourd’hui d’éviter les tensions sur l’arbitrage des CAPEX. Les réactions de déresponsabilisation tendent à disparaitre. L’on cesse de se renvoyer la faute entre employés et équipes de direction, les sentiments d’injustice s’effacent.
Bien sûr, d’autres éléments liés à l’organisation traditionnelle des entreprises sont remis en question par ces évolutions. D’abord, les syndicats doivent repenser leur rôle et leurs responsabilités. Comme cela a été le cas chez Poult, il y a fort à parier qu’ils soient coopérants, dans la mesure où ils perçoivent que l’intérêt des employés est plus que préservé. Se pose ensuite l’inévitable question de la rémunération et donc de la valeur ajoutée de chacun. Chez Poult un système équitable de participation et d’intéressement a été mis en place : les collaborateurs perçoivent 7% du résultat d’exploitation en intéressement ; l’ouverture du capital est de plus fortement revendiquée auprès de l’actionnariat, sans être acquise pour autant. Mais dans le discours, il semble qu’il vaille mieux éluder la question de la valeur ajoutée, car se la poser revient à re-individualiser et à mécaniser l’homme. Ainsi la seule manière d’évaluer la contribution de chacun à l’entreprise serait de se référer à ses pairs : des équipes de rémunération de 15 personnes (pour 90 cadres) ont été formées pour décider des évolutions de salaire en évaluant le niveau d’engagement des collaborateurs au service du collectif. L’on observe donc un déplacement significatif des critères de rémunération ; autrefois l’expertise, l’expérience, l’ancienneté, la place hiérarchique, aujourd’hui le niveau d’engagement et de collaboration.
La transformation vers l’entreprise collaborative est longue et implique un changement extrêmement profond des mentalités et des structures. Ce sont les processus réels de décision qui font qu’une entreprise est collaborative, ce qui suppose souvent de s’attaquer à l’épine dorsale du système pour les voir redéfinis. La difficulté est qu’il ne faut pas s’y attaquer par le haut, mais déjà de manière collaborative, pour que la transformation fonctionne. C’est le problème de la poule et de l’œuf. « Soyez collaboratifs » fait dans notre cas figure d’oxymore ; le dirigeant doit être capable de dire « collaborons à être collaboratifs ». En outre, notre système a cette capacité de remalaxer tous les concepts puis de les réintégrer pour finalement ne rien changer, ce pourquoi il faut à tout prix se méfier des apparences, et lorsqu’on est dirigeant mener la transformation en gardant ces mots en tête : « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. » (Gandhi).

Aurélie Duthoit
A une époque où le digital permet de copier immédiatement presque tous les savoir-faire, la seule valeur ajoutée de l’entreprise pourrait bien être sa communauté (de collaborateurs et de clients). En ce sens la dichotomie experts-sachants/exécutants est obsolète, tout comme l’idée de confier le département innovation à 2-3 personnes qui ont la tête bien faite, qui iront voyager pour puiser des idées. « Au mieux vous aurez une super idée, mais vous aurez une réalisation médiocre et le temps qu’elle arrive sur le marché ce sera dépassé. » L’innovateur est celui qui est capable de transformer une idée en comportement collectif, autrement dit qui est capable de faire de l’innovation l’affaire de tous.
Au moins trois caractéristiques doivent se retrouver dans toute entreprise collaborative : (1) La confiance, car le contrôle coûte cher, et la confiance a priori, surtout pour des personnes recrutées à dessein, est tout à fait efficace. (2) L’optimisation des ressources disponibles, ce qui revient à appliquer les principes de l’économie collaborative à l’intérieur même de l’entreprise. Les collaborateurs ne sont égaux ni à des fiches de poste ni à des fonctions : ils peuvent avoir de bonnes idées à l’extérieur qui seront réutilisables en entreprise. C’est ainsi qu’un salarié d’IMA technologie, féru de théâtre, a un jour proposé un mode de formation des salariés sur le principe de petits sketches. Aujourd’hui une entreprise au sein d’IMA technologie vend ces formats de formation aux clients… C’est là un bon exemple d’optimisation des ressources disponibles. (3) La contribution. Chacun doit contribuer, tout simplement. Un bel exemple de succès de management par la contribution est celui de l’entreprise Sol, qui emploie des femmes de ménage, un type d’employées aux possibilités d’initiative considéré comme traditionnellement faibles. Dans le souci de mieux valoriser leur activité, il a été décidé qu’elles travailleraient dorénavant la journée plutôt que la nuit. Ce simple fait d’entrer en contact avec les clients leur a permis de mieux cerner les besoins de ces-derniers et de commencer à proposer des idées. De fil en aiguille, cela a permis la mise en place d’options venant enrichir l’offre standard, options qui aujourd’hui représentent 15% de la marge brute de Sol… La valeur créée par le collaboratif est parfois bien concrète.
Le rôle du manager dans l’entreprise libérée a vocation à être redéfini, et ce en renversant la perspective et évitant l’approche trop fonctionnelle du « qui fait quoi ? », c’est-à-dire en se demandant comment optimiser la collaboration et a posteriori les fonctions qui en découlent. Les middle managers, dont les postes ont été créés pour plus de reporting et de contrôle n’ont plus aucune utilité si l’on se cantonne à l’approche fonctionnelle, pourtant il est évident qu’ils peuvent apporter leur pierre à l’édifice collaboratif. Ce raisonnement peut en fait s’étendre à presque tous les métiers de l’entreprise, lesquels se font progressivement uberiser. Les DRH en sont un exemple frappant : ils assistent à la multiplication des logiciels de gestion et de cartographie des compétences, de formation, etc. qui offrent aux employés d’autres possibilités de répondre à des besoins qu’ils avaient pour habitude de prendre en charge. Les employés peuvent maintenant rapidement trouver une formation ou un partenaire doté d’une compétence spécifique grâce aux outils mis en place par l’entreprise, et n’ont plus besoin de l’aide du personnel des Ressources Humaines. Pour sauvegarder leur valeur ajoutée, les Direction des Ressources Humaines se voient donc contraints de développer des compétences qui ne peuvent pas encore être concurrencées par des outils digitaux ; par exemple, certains commencent à se former aux outils tels que les tests MBTI, cela leur permet de recruter sur d’autres critères que les compétences techniques, comme la compatibilité avec les autres profils de la future équipe de travail du candidat. Toutefois, il ne s’agit pas là d’improviser une solution pour maintenir un sens artificiel à leur fonction, mais bien de repenser ce sens relativement à un contexte qui a évolué ou va le faire. En prenant la valorisation de l’intelligence collective plutôt que celle de l’intelligence individuelle comme source des fonctions dans l’entreprise, de nouveaux rôles et de nouveaux métiers s’imposeront d’eux-mêmes, ce que doivent comprendre les Direction des Ressources Humaines et à terme tous les managers et leaders.
Le rôle de ces derniers devient donc essentiellement d’optimiser la collaboration, de faire en sorte que chacun puisse exprimer tous ses talents, ce qui est antinomique avec la restriction à une fonction préalablement définie et intangible. Si le leader continue d’ordonner, contraindre, cela doit être dans le souci de libérer et de fluidifier et non plus de maitriser et prévoir.
Anne-Claire Rodary
C’est en s’inspirant des outils du design thinking que la division Cognac & Champagnes de Pernod Ricard a expérimenté l’instauration du travail collaboratif auprès de quelques équipes ciblées. Appliqué à l’innovation et au management, le design thinking est par nature une approche collaborative. C’est une démarche empathique, « human centric », aux antipodes d’une vision technocentrée de l’innovation. En effet, elle vise à concilier ce qui est désirable du point de vue de l’humain, qu’il soit consommateur ou collaborateur, et ce qui est techniquement viable et souhaitable économiquement. Cette pratique peut donc en théorie s’appliquer à l’innovation produit, service, à l’innovation d’expérience, mais aussi à d’autres formes de sujets complexes comme les problématiques RH, stratégiques, organisationnelles, etc.
L’on peut distinguer deux niveaux d’apport du design thinking. Le premier prend sa source dans l’ouverture de l’entreprise sur elle-même et sur l’extérieur. Travailler en design thinking, c’est ne plus faire travailler les départements de manière isolée mais instaurer une logique multidisciplinaire qui va favoriser l’intelligence collective. C’est aussi s’ouvrir aux apports extérieurs, pour augmenter son champ d’expertise, de réflexion, trouver des sources d’inspiration, etc. Le deuxième niveau d’apport prend forme dans l’application du design thinking à des volets organisationnels et managériaux. Effectivement, la démarche « human centric » peut être un outil très puissant pour une amélioration durable de l’entreprise, justement car elle met l’humain au centre des questionnements. Utiliser le design thinking est en ce sens un bon moyen de mobiliser les collaborateurs dans la reconstruction de leur environnement de travail.
L’expérience chez Pernod a démarré il y a deux ans et ses effets sont encore timides. Il reste 8 ans (un horizon à 10 ans ayant été visé au début de l’expérience) pour atteindre l’objectif de renforcer la capacité d’innovation et de promouvoir une culture collaborative dans l’entreprise. Cela représente un vrai défi, dans la mesure où le management chez Pernod Ricard est traditionnellement très hiérarchique, contrôlant. Il y un important travail d’acculturation à effectuer, auprès de cadres qui pour la plupart n’ont même jamais entendu parler du design thinking. La mise en application a donc été délicate dès le départ : il a d’abord fallu concevoir une formation à la mise en application du design thinking. Un ensemble de designers pionniers a ainsi été formé, se réunissant par groupe de 20 sur la durée d’un an. Simultanément, à l’issue de chaque session de formation, des mises en application concrètes ont été organisées, avec une vingtaine de projets (d’IPD, sourcing, industriels, évènementiels, etc.), eux-mêmes issus du grand projet de l’entreprise. Enfin un système de coaching à la demande a été mis en place pour tous les pilotes, ceux-ci y faisant appel en fonction de leur propre zone d’inconfort.
Finalement, 150 collaborateurs ont jusqu’ici été exposés au design thinking. Si Pernod Ricard n’est pas encore devenu une réelle entreprise collaborative, le design thinking a déjà porté ses fruits, et les retours d’expérience effectués au début de l’année 2015 ont été très encourageants. Au-delà de l’apport en termes d’innovation, il est très clair que cette démarche a un impact humain positif.
Suzie Lewis
Airbus a mis en place un espace collaboratif dédié à l’innovation, baptisé le Protospace. Cette initiative n’est pas isolée et résulte d’une volonté de grande transformation chez Airbus : création de nouvelles divisions, de centres d’innovation technologique et commerciale, changement d’identité (de EADS à Airbus group)… Cette transformation de process s’accompagne d’une évolution des personnes qui travaillent dans l’entreprise.
Protospace est un endroit où l’on peut prototyper, innover, partager ses idées… Les locaux ont volontairement été mis en place à côté des sites de travail pour « faire la différence entre ce qui se passe dans le quotidien et ce qu’on peut faire par le suite ». Ils comprennent : un théâtre où les powerpoints ne sont pas conviés, des salles de créativité, d’innovation, et des salles de sprint, qui peuvent être réservées par les managers et leurs équipes pour une centaine de jours, afin qu’ils puissent créer ensemble leurs valeurs, leur projet, leur but commun, leur propre écosystème qui leur permette de prototyper avec une agilité, une rapidité qu’ils n’ont pas dans l’entreprise aujourd’hui.
Aujourd’hui encore Airbus se trouve loin d’une culture de partage des idées, la lutte d’égos est toujours bien présente, et une difficulté qui se présente est celle d’offrir plus d’autonomie aux collaborateurs tout en évitant leur individualisation. Pour cela, Airbus tente notamment de leur enseigner l’intelligence émotionnelle, la conscience de soi, du collectif, le rôle du leader.
D’autres initiatives ont pu voir le jour, comme la création de « biz labs » : Des intrapreneurs d’Airbus peuvent y rencontrer des entrepreneurs de l’extérieur, afin de comprendre leur rapidité de prototypage, de s’inspirer, et plus généralement de sortir des carcans mentaux.
En résumé, il y a eu du changement, il reste des freins et beaucoup de chemins à parcourir, mais la direction empruntée est très certainement la bonne.
Propos recueillis par Clément Berardi, Julien Eymeri et Louis Gall
http://www.choisirquartierlibre.com/

_____________
Partenaires du Cercle :